Accueil > Docs > En dix ans, un squatt de Ris-Orangis a acquis,grâce à son efficacité, une (...)
En dix ans, un squatt de Ris-Orangis a acquis,grâce à son efficacité, une honorabilité
LE MONDE | 02.09.92 |
mercredi 29 septembre 2010, par
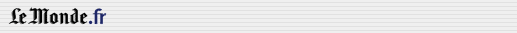
Banlieue-laboratoire
En dix ans, un squat de Ris-Orangis a acquis, grâce à son efficacité, une honorabilité
Au commencement était une caserne désaffectée de l’armée de l’air. Une dizaine de bâtiments et de hangars sans eau ni électricité pillés de tous leurs matériaux. Ainsi se présentait cet espace abandonné de 12 000 mètres carrés il y a onze ans. Aujourd’hui, c’est un village de 70 habitants comptant 45 emplois, un village dans la ville de Ris-Orangis (Essonne), en bordure de Seine, à deux pas de la gare. On y trouve, outre des entreprises (imprimerie, menuiserie, garage...) et des associations (accueil d’adultes handicapés, création de spectacles, par exemple), un café musique, des salles de concert, des studios d’enregistrement, un centre d’hébergement d’urgence, ainsi que de nombreux ateliers d’artistes ; toutes ces activités s’inscrivant dans un projet d’ensemble associatif baptisé Centre autonome d’expérimentation sociale (CAES).
A l’origine de la renaissance de cette friche, « quinze jeunes de banlieue entreprenants, créateurs, comme ils se définissent eux-mêmes, prenaient l’initiative d’ouvrir ce squatt pour changer leurs conditions de vie, d’habitat et de travail ». La « prise » de la caserne a eu lieu en juillet 1981. Aujourd’hui encore, ses auteurs se réfèrent à ce qui inspira leur démarche : le rapport de Bertrand Schwartz sur « l’immersion professionnelle et sociale des jeunes », qui préconisait notamment d’encourager « des expériences en matière d’habitat de nature à accroître l’appropriation de l’espace » par les jeunes, leur permettant de gérer eux-mêmes leur cadre de vie. Bertrand Schwartz voulait-il ainsi inviter les jeunes à squatter ? Il n’empêche que dans l’Essonne, ils ont pris le message au pied de la lettre. Et ils ont eu raison car, après dix années d’une existence parfois agitée, la reconnaissance est venue. En effet, le CAES a signé, en février 1991, une convention d’occupation d’un an avec le ministère des affaires sociales, propriétaire des lieux, qui devrait déboucher, d’ici à fin 1992, sur un bail de longue durée.
Échanges d’expériences
Pourquoi un tel soutien à cette occupation sauvage ? Alors que plusieurs banlieues s’étaient déjà enflammées, les pouvoirs publics ont estimé qu’il existait ici un équilibre social à préserver, « un creuset de pistes, de réponses, important pour les institutions confrontées à la révolte des jeunes dans les cités », affirme Jeanne Levasseur, chargée de mission au Plan urbain, un centre de recherche et d’expérimentation rattaché au ministère de l’équipement. Cette expérience fascine et trouble le visiteur tant elle ne s’inspire d’aucun modèle, tant elle évolue chaque jour au gré des énergies et des projets, des conflits et des espoirs. Un objectif permanent se dégage toutefois : vivre et travailler ensemble dans un site autogéré collectivement - les loyers s’élèvent en moyenne à 600 francs mensuels. Mais, « plus que de donner du travail, il s’agit pour chacun de créer son emploi », insiste Jean-François Perreau, dit Jef, cofondateur et « âme du CAES », selon certains. Une recherche d’autonomie qui s’appuie sur la solidarité et l’échange d’expériences.
Car le CAES est aussi un lieu ouvert sur l’extérieur où viennent des groupes de musique -150 concerts ont déjà eu lieu, -des peintres du monde entier, des troupes de théâtre. « 500 ou 800 personnes ont habité ici, pour des périodes variant de trois jours à onze ans », souligne Jef. Il en résulte un mélange de profils et de motivations. Jef, par exemple, a travaillé cinq ans dans une entreprise en tant que dessinateur industriel. II jouait aussi de la musique dans son pavillon de Vigneux (Essonne). Jusqu’au jour où un voisin, excédé par le bruit, a sorti son fusil... Ce fut le déclic. Au CAES, il a monté plusieurs entreprises, dont ETAIR, qui réalise des travaux acrobatiques sur des bâtiments, et 7D, fabricant de murs d’escalade et de décors. Cette entreprise a si bien marché - elle a salarié jusqu’à 25 jeunes en même temps et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions de francs en 1990 - que Jef a voulu la stopper. « Ce qui nous intéresse, ce sont les activités intermittentes, s’investir quelques mois, puis reprendre autre chose, souligne-t-il. Avoir des salariés de plus en plus stables, des postes bien déterminés, un chiffre d’affaires qui grimpe, ce n’est pas notre but. Nous allons reprendre cette activité, mais pour des chantiers ponctuels. » Entre deux missions, les gens travailleront pour d’autres structures du CAES, à l’organisation de spectacles, ou bien sur le vaste chantier permanent de réhabilitation des bâtiments, dont certains manquent encore cruellement de confort. « Ce fonctionnement permet d’avoir des charges minimales et des rapports différents entre les gens. Chacun à ses responsabilités. » La précarité ne lui fait pas peur. « Je vis beaucoup mieux si je ne sais pas de quoi demain sera fait. Dans cet espace, où tant d’expériences se télescopent, je ferai toujours quelque chose. »
Dilip, lui, est arrivé au CAES à bout de souffle. Batteur rock, il possède aussi un CAP de mécanique... qui ne lui a jamais servi. Faire des petits boulots, jouer de la musique dans les caves, il en a eu assez. « J’avais un appartement, une épouse. J’ai tout abandonné pour venir ici essayer de vivre de la musique. » Dilip travaille aujourd’hui à l’association Tempo, qui loue des salles de répétition et d’enregistrement du CAES, et donne des cours gratuits de batucada, une sorte de percussion brésilienne, aux jeunes de la région. « Je vis avec 2000 à 3500 francs par mois, mais j’ai enfin l’impression d’avoir la tête sur les épaules. »
Pour les jeunes en grande difficulté, le CAES peut être un tremplin. C’est le cas de Smina, qui dirige aujourd’hui le centre d’hébergement d’urgence qu’elle a créé en 1985. II accueille pour de courtes durées des jeunes marginaux envoyés par les assistantes sociales, la DASS, le comité de probation d’Evry, qui versent au centre 60 francs par nuit et par jeune. Comme ses pensionnaires, Smina vient de la « zones ». Elle quitte sa famille à seize ans, avant de « galérer dans la rue pendant dix ans », un CAP de sténo-dactylo en poche. Elle atterrit au CAES en 1981. Pendant trois ans, elle va « zoner » dans les lieux avant de reprendre sa vie en main. Un local accueillait alors des enfants en semaine pour des cours de théâtre. Smina eut l’idée de l’ouvrir le week-end, « pour donner un toit aux jeunes de la rue ».
Des poumons de survie
Aujourd’hui, le centre tourne à plein régime, mais Smina, elle, gagne seulement 4 200 francs par mois, travaillant « sept jour sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ». Il faudrait trois personnes au lieu d’une seule pour gérer ce lieu. Aussi, « pour attirer l’attention » sur cette situation, Smina a décidé de fermer le foyer cet été. Il devrait rouvrir en septembre, et voler alors de ses propres ailes sous forme de structure autonome du CAES avec des subventions, espère-t-elle. Smina compte aussi aller vivre ailleurs, juste de l’autre côté de la rue, pour prendre de la distance. Une belle preuve d’insertion.
D’autres, en revanche, cherchent encore leur chemin. Car l’insertion est parfois longue et difficile, et la vie collective contraignante. Les tâches administratives, par exemple, retombent souvent sur les mêmes qui, à la longue, se fatiguent. Et chaque problème relationnel rejaillit sur tout le groupe, bien obligé de le gérer. Et puis « il y a toujours quelque chose à faire ici, souligne Greg, technicien du spectacle de l’association Cats 91, implantée au CAES. Quand on voit l’état des bâtiments, les problèmes humains... Moi, j’ai besoin d’en partir pour pouvoir revenir ». « Le CAES, c’est un miroir, estime James, tapissier-décorateur et chorégraphe. Il faut être fort pour y vivre. Quand on y réussit, on peut vivre partout. » Et le CAES, comme la société, connaît des crises, des replis sur soi.
L’avenir, pourtant, nécessitera la mobilisation de chacun. Car le CAES se trouve à un tournant menant à une organisation plus structurée. Déjà, le souci de créer et de pérenniser les emplois a été pris en compte, certaines activités ayant du mal à se développer par manque de rigueur de gestion et de sens de l’organisation. Aussi, l’association OPALE (Organisation pour projets alternatifs et d’entreprise) a choisi de faire du CAES son site expérimental dans l’Essonne, dans le cadre du programme national de l’Agence pour le développement des services de proximité. OPALE offrira de la formation, du conseil et de l’accompagnement de projet dans le domaine culturel. Une initiative financée par le Fonds social européen, la DDTE, et le Plan urbain. Une entreprise d’insertion devrait également voir le jour. De plus, le CAES a reçu une subvention pour faire réaliser une étude socio-urbanistique destinée à trouver des solutions pour améliorer le confort du lieu et mieux l’intégrer dans la ville tout en préservant sa spécificité et son autonomie. Mais déjà, les regards extérieurs ont changé : « Les policiers ne nous parlent plus sur un ton autoritaire comme il y a dix ans », affirme Jef. « On a besoin de nous, renchérit Cris, autre cofondateur. Il faut prendre en compte le coût de la délinquance évitée pour des jeunes qui, s’ils ne vivaient pas avec nous, sèmeraient peut-être l’agitation dans les banlieues. Et tout ce travail social, nous l’avons fait sans aucune subvention. »
Même la mairie, qui n’a jamais été un franc supporter du CAES, a modifié son discours : « II y a deux ans, j’aurais dit que tout est à raser », lance Jérôme Renucci, premier adjoint (PS) au maire, chargé de l’urbanisme. Aujourd’hui, il reconnaît que « la dimension culturelle et sociale s’est imposée » à lui et va jusqu’à « regretter qu’on ne fasse pas plus pour ces jeunes gens ». Avoir le courage de faire confiance à des jeunes motivés, les laisser créer des poumons de survie, c’est peut-être la première leçon à tirer de cette expérience, comme le soutient Jeanne Levasseur, du Plan urbain, « sinon, dit-elle, on arrive à l’exclusion, aux SDF, à la marginalité ».
F. A.
